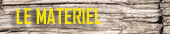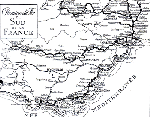| En regardant la Gare du Sud aujourd’hui, on se pose immanquablement deux questions :
- Pourquoi est-elle si grande ?
- Pourquoi est-elle dans un tel état de décrépitude ?
Les amateurs de trains se posent une troisième question :
- Ou sont les trains ?
C’est en s’intéressant à l’histoire d’un bâtiment que l’on peut répondre à ces questions.
Ensuite, en projetant l’histoire vers le futur, on peut imaginer une suite logique… ou illogique?
L’histoire
de cette gare est intimement liée à celle des Chemins de fer de
Provence. C’est pourquoi nous allons, dans un premier temps, remonter
bien avant sa construction.
AVANT LA GARE
LES PREMIERS RAILS DU COMTE DE NICE
Bien
avant la création des Chemins de fer de Provence – ou du Sud de la
France -, des rails pour les transports des marchandises ont été posés par
le Comté de Nice sur la nouvelle digue du Var, entre Lingostière et
Baus-Roux (écartement 1.50 m).
Les premiers
rails sont apparus sur cette ligne le 16 juin 1845. A cette époque le
Comté de Nice faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne.
Afin
de créer une digue sur la rive gauche du Var sur une douzaine de
kilomètres entre La Roquette et Aspremont, une ligne de chemin de fer
fut établie. Cette voie fonctionna à partir de 1854 sur une longueur de
11,454 km, un unique wagon plat tiré par un mulet transportait quelques
voyageurs téméraires.
En 1860, à la veille de
l’annexion du Comté de Nice par la France, la ligne, toujours à
traction animale, faisait 23.1 km de long, entre Baus-Roux et
l’embouchure du Var (au niveau du futur aéroport).
L’ANNEXION ET LE PLAN FREYCINET
La ligne des Alpes
En
1861, la récente annexion de Nice fit naître des projets d’une liaison
Paris-Nice plus directe que celle passant par Marseille. Un axe rapide
Lyon-Grenoble-Gap-Digne-Nice faisait son chemin dans les esprits. Ce
fut une idée visionnaire à une époque où aucune route n’existait encore
dans la vallée du Var. Puget-Théniers, nouvelle sous-préfecture,
n’était reliée à la côte que par un chemin muletier.
Le plan Freycinet
L’arrivée
de Charles de Freycinet au Ministère des travaux publics modifia
profondément le paysage ferroviaire français. Une loi portant son nom
classa d’utilité publique 181 lignes de chemin de fer d’intérêt
général.
Seules deux sections nous concernant furent rapidement déclarées d’utilité publique pour leur réalisation :
- De Digne à Castellane le 28 juillet 1881
- De Draguignan à Grasse le 4 août 1882
Cette
fois-ci, ce sont les élus des Alpes-Maritimes qui furent insatisfaits,
Nice n’ayant de liaison efficace ni vers Digne, ni vers le
« Central Var », et proposèrent une subvention d’un million
de francs pour l’exécution de ces deux axes. Ces sections ont été
finalement étudiées par décision du ministre le 13 mai 1881.
La genèse du « Central Var »
L’annexion
du Comté de Nice créa divers bouleversements. D’une part,
l’arrondissement de Grasse fut perdu par le Var au profit du nouveau
département des Alpes Maritimes. D’autre part, une nouvelle ligne de
chemin de fer fut instaurée de Marseille à Nice. Ces deux évènements
provoquèrent l’indignation d’élus varois, qui, non seulement perdaient
une partie du département, mais virent la grande ligne de chemin de fer
éviter les grandes villes de Brignoles, Draguignan et Grasse. Des
comités se succédèrent afin de créer une seconde ligne centrale pour
ces deux départements. Le 24 janvier 1872, un effondrement entre
Antibes et Cagnes mit en évidence la fragilité de l’unique lien
ferroviaire.
ADOPTION DE LA VOIE METRIQUE SUR LA LIGNE DU CENTRAL VAR
En
raison de coûts élevés, l’adoption de la voie métrique, et un nouveau
tracé de la ligne est préconisé par l’Etat pour la ligne
Nice-Meyrargues. Ce tracé, beaucoup pus sinueux que celui prévu
initialement, détruit les rêves des élus locaux qui préconisaient un
« Central Var » rapide, desservant les communes de
l’arrière-pays du Var et des Alpes-Maritimes, alternative crédible à la
voie du littoral.
Jusqu’alors,
tous les projets avaient été conçus pour un écartement de voies
standard, les lignes à voie métrique étant une exception en France.
Mais au fur et à mesure de la publication des avants-projets des lignes
à construire, les coûts au kilomètre, établis initialement à 200.000
francs, dépassaient les 300.000 francs pour Digne-Castellane et même
600.000 francs pour Draguignan-Grasse. A partir de 1882, les ministres
qui se succédaient au ministère des travaux publics envisagèrent des
solutions plus économiques, dont la réalisation à voie étroite et la
concession à des sociétés privées. La décision fut prise en 1883 et
1884, alors que la concession Digne-St-André avait déjà été attribuée
et les travaux avaient été entrepris pour une ligne à voie normale.
Le
tracé de la ligne « Central Var » fut redessiné, plus sinueux
et moins coûteux, et le PLM annula sa concession du Digne-St-André, la
compagnie se déclarant inapte à gérer une ligne à voie étroite.
La Compagnie des Chemins de Fer du Sud de la France fut créée pour reprendre les concessions.
Pendant
ce temps, sur la ligne des Alpes, les travaux débutèrent entre Digne et
Saint-Jurson pour la construction d’une ligne à voie normale destinée
aux PLM.
CONSTITUTION DE LA
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD DE LA FRANCE
La
Compagnie « Sud-France » fut officiellement créée le 17 Août
1885, et devait assurer l’exploitation pour 99 ans des futures lignes
Draguignan-Meyrargues, Draguignan-Grasse, ainsi que des concessions
éventuelles Grasse-Nice, Digne-Draguignan et Saint-André-Nice, cette
dernière section ayant été transformée à voie métrique.
LES TRAVAUX ET INAUGURATIONS DE LIGNE
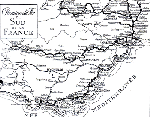 Le Central-Var Le Central-Var
Les travaux débutèrent de Draguignan à Meyrargues le 14 juin 1886.
Les
travaux débutèrent sur l’ensemble de la ligne du
« Central-Var » entre 1886 et 1887, alors que les élus
dénonçaient à la fois un tracé trop sinueux et des gares trop
lointaines de certaines localités d’importance (Villecroze à 4km, Aups
à 9km). Pour la première fois en France, une ligne à voie étroite
atteignit une centaine de kilomètres de long. Le premier tronçon
Draguignan-Salernes fut officiellement ouvert le 23 avril 1888. Le 27
août, la ligne rejoignit Barjols, puis le 28 janvier 1889 le terminus
de Meyrargues. L’inauguration officielle de la ligne
Draguignan-Meyrargues eut lieu le 22 mars 1889.
La
construction de la section Draguignan-Grasse, dans un relief nettement
plus tourmenté, nécessita la construction d’ouvrages d’art
remarquables, tels que le viaduc de la Siagne (pont métallique de 72
mètres de hauteur) ou le viaduc du Rayol. Son ouverture au public eut
lieu le 8 novembre 1890.
Elle sera totalement
ouverte de Nice à Meyrargues le 7 juin 1892, date de l’inauguration de
la Gare du Sud.
La ligne du Littoral
Les travaux débutèrent de La Foux à Saint-Raphaël en mars 1888.
La ligne du Littoral fut inaugurée le 25 août 1889
entre Saint-Raphaël et la Foux, appelée alors « Cogolin-Saint-Tropez ».
La ligne sera ouverte à l’exploitation le 19 Septembre. Le 4 août 1890,
la ligne du littoral fut totalement ouverte à l’exploitation de Hyères
à Saint-Raphaël.
Cette
ligne, intitialement prévue de St-Raphael à Hyères, puis prolongée à
Toulon, devait se raccorder sur la ligne du Central Var et créer un
grand faisceau. Cette jonction ne sera jamais faite.
La ligne des Alpes
La
première section de la ligne des Alpes, côté Digne, fut ouverte à
l’exploitation sur une distance de 12.8 km le 31 Août 1891, puis de
Digne à Saint-André le 15 mai 1892. Côté Nice, le premier tronçon fut
ouvert à l’exploitation commerciale le 7 juin 1892. Ce début de ligne
était le tronçon commun avec la ligne du Central-Var, de Nice à
Colomars.
La concession Nice-Puget sera entièrement ouverte à l’exploitation
commerciale le 8 août 1892. Il faudra attendre le 3 juillet 1911 pour
que la ligne des Alpes soit totalement ouverte, de Nice à Digne.
LA CONSTRUCTION DE LA GARE
A l’automne 1890 les travaux de construction de la nouvelle gare du Sud débutent.
L’EMPLACEMENT
 Lorsque
la gare de Nice PLM (SNCF) a été construite en 1863, les niçois ont été
pour le moins sceptiques : cette gare se situait dans le quartier
Saint Etienne, au milieu des vergers et des cressonnières, loin des
nouveaux quartiers urbanisés de Nice.En 1889, c’est encore plus au nord que l’emplacement pour la Gare du Sud est réservé.Cet
emplacement excentré est imposé par des impératifs stratégiques et
militaires. La France vient de sortir de la guerre de 1870. En cas
d’attaque maritime, la ligne PLM (future SNCF), longeant le littoral,
est très vulnérable.La nouvelle ligne doit
être à l’abri des coups de canons maritimes de l’ennemi. Son tracé à la
sortie de Nice évite la côte par un parcours sinueux dans le vallon de
la Madeleine, puis la ligne de Meyragues ne traverse le Var qu’au
niveau de la Manda, loin des côtes.Or la dénivellation importante ne permet pas « facilement » le raccordement des deux lignes.A
l’emplacement de la Gare du Sud, les ingénieurs voyaient, en outre, un
futur pôle d’attraction urbain pour les nouveaux quartiers de Nice. Lorsque
la gare de Nice PLM (SNCF) a été construite en 1863, les niçois ont été
pour le moins sceptiques : cette gare se situait dans le quartier
Saint Etienne, au milieu des vergers et des cressonnières, loin des
nouveaux quartiers urbanisés de Nice.En 1889, c’est encore plus au nord que l’emplacement pour la Gare du Sud est réservé.Cet
emplacement excentré est imposé par des impératifs stratégiques et
militaires. La France vient de sortir de la guerre de 1870. En cas
d’attaque maritime, la ligne PLM (future SNCF), longeant le littoral,
est très vulnérable.La nouvelle ligne doit
être à l’abri des coups de canons maritimes de l’ennemi. Son tracé à la
sortie de Nice évite la côte par un parcours sinueux dans le vallon de
la Madeleine, puis la ligne de Meyragues ne traverse le Var qu’au
niveau de la Manda, loin des côtes.Or la dénivellation importante ne permet pas « facilement » le raccordement des deux lignes.A
l’emplacement de la Gare du Sud, les ingénieurs voyaient, en outre, un
futur pôle d’attraction urbain pour les nouveaux quartiers de Nice.
LES TRAVAUX
Les
ingénieurs du « Sud-France » prévoyaient d’emblée une gare
monumentale, à hauteur des ambitions de la jeune compagnie.Cette
gare devait être le terminus de 350 kilomètres de lignes, traversant 4
départements, sans compter les différents projets (non aboutis)
dépassant allègrement les 500 kilomètres de lignes.La Compagnie Sud France prenait soin de mettre en valeur toutes ses gares terminus
« définitives » : Deux gares monumentales (Toulon et
Nice) et deux gares plus modestes, mais à la finition soignées (Digne
et Meyrargues).Malgré la désapprobation de
certains parlementaires, le projet monumental de la Gare du Sud fut
approuvé au Sénat le 13 juillet 1889. allègrement les 500 kilomètres de lignes.La Compagnie Sud France prenait soin de mettre en valeur toutes ses gares terminus
« définitives » : Deux gares monumentales (Toulon et
Nice) et deux gares plus modestes, mais à la finition soignées (Digne
et Meyrargues).Malgré la désapprobation de
certains parlementaires, le projet monumental de la Gare du Sud fut
approuvé au Sénat le 13 juillet 1889.
 La
réalisation fut confiée à l’architecte Prosper Bobin, élève d'Hittorff
qui a conçu la gare du Nord à Paris, mais aussi frère d’Hippolythe
Bobin, sous-directeur de la Compagnie…Il applique ici les principes du Manifeste Archéologique inspiré de la coloration des temples grecs (voir ci-contre "la Gare du Sud en détails").
La nef est de Baltard, l'ingénieur des Halles de Paris. Elle servit
initialement à abriter le pavillon russe de l'exposition universelle de
1889. Les sculptures sont signées Léon Pilet.Il s’agit de l’oeuvre majeure de Prosper BOBIN, architecte en chef des Bâtiments La
réalisation fut confiée à l’architecte Prosper Bobin, élève d'Hittorff
qui a conçu la gare du Nord à Paris, mais aussi frère d’Hippolythe
Bobin, sous-directeur de la Compagnie…Il applique ici les principes du Manifeste Archéologique inspiré de la coloration des temples grecs (voir ci-contre "la Gare du Sud en détails").
La nef est de Baltard, l'ingénieur des Halles de Paris. Elle servit
initialement à abriter le pavillon russe de l'exposition universelle de
1889. Les sculptures sont signées Léon Pilet.Il s’agit de l’oeuvre majeure de Prosper BOBIN, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux ainsi que membre du jury de l'Ecole des
Beaux-Arts, connu aussi pour avoir réalisé le Palais de l'Optique à
l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et l'église de Ste Anne,
toujours à Paris.La gare juxtapose deux
parties distinctes par leur fonction, leurs matériaux, leur
architecture et leur symbolique. A l'avant, le bâtiment des voyageurs,
en pierre, briques et tuiles, reflète la redécouverte de la polychromie
de l'architecture antique prônée par Hittorff. A l'arrière, la grande
halle métallique abrite les quais, pour l'essentiel remployée du
pavillon de la Russie et de l'Autriche-Hongrie à l'exposition
universelle de Paris en 1889 (Descriptif du ministère de la culture).
civils et Palais nationaux ainsi que membre du jury de l'Ecole des
Beaux-Arts, connu aussi pour avoir réalisé le Palais de l'Optique à
l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et l'église de Ste Anne,
toujours à Paris.La gare juxtapose deux
parties distinctes par leur fonction, leurs matériaux, leur
architecture et leur symbolique. A l'avant, le bâtiment des voyageurs,
en pierre, briques et tuiles, reflète la redécouverte de la polychromie
de l'architecture antique prônée par Hittorff. A l'arrière, la grande
halle métallique abrite les quais, pour l'essentiel remployée du
pavillon de la Russie et de l'Autriche-Hongrie à l'exposition
universelle de Paris en 1889 (Descriptif du ministère de la culture).
L’EXTENSION DE LA GARE
Cette
gare, qui paraissait monumentale, ainsi que ses extensions, voies,
remises, quais, lui ont permit de jouer un rôle de plus en plus
important, de sa création à la fin de la seconde guerre mondiale.
RACCORDEMENT DES DEUX GARES A NICE
Pour
épargner des terrains de grande valeur à Nice, malgré une faible
urbanisation du quartier, on adopta le 1er mars 1889 le principe de la
voie sur rue pour le raccordement entre la gare PLM et la Gare du Sud,
distantes de moins de 400 mètres. (Rue des Combattants en AFN, ex-Rue
Falicon). Les études d’une voie en site propre, pourtant faites, ne
furent pas suivies. Cette solution économique causera l’isolement
actuel de la Gare du Sud.
LES DEBOUCHES DES TRAMWAYS ET
L’EXTENSION DES RESEAUX FERRES A ECARTEMENT METRIQUE
Deux grandes concessions pour la construction et
l’exploitation des tramways dans le département des Alpes-maritimes
furent accordées. La TNL (Tramways de Nice et du littoral) exploitait
essentiellement les nouveaux tramways de Nice et de la Côte ; Les TAM
(Tramways des Alpes-Maritimes) exploitaient les tramways des vallées et
du haut pays. Il est à noter, concernant les TAM, qu’ils étaient
exploités par les Chemins de fer du Sud de la France. Ces derniers
n’utilisèrent jamais le vocable TAM pour leurs tramways, les assimilant
aux autres lignes de chemin de fer.Tous les tramways étaient à
écartement métrique, comme les lignes du Sud France, ce qui facilita
grandement l’épanouissement de la Gare du Sud à Nice et des lignes en
général, grâce aux multiples jonctions qui pouvaient être établies. Les
nombreux transports de marchandises pouvaient se faire sans
déchargement, par des wagons qui empruntaient tour à tour les
différents réseaux. Les Tramways de Nice et du LittoralEn
1905, une convention fut signée avec la ville de Nice pour un
raccordement avec les Tramways TNL. Ce raccordement, situé au niveau du
PN Gambetta, permettra Les Tramways de Nice et du LittoralEn
1905, une convention fut signée avec la ville de Nice pour un
raccordement avec les Tramways TNL. Ce raccordement, situé au niveau du
PN Gambetta, permettra aux wagons du Sud France de rejoindre le port de Nice, et favoriser
ainsi les échanges commerciaux entre l’international (via le port) et
le haut pays sans transbordement (les tramways de Nice sont alors en
écartement métrique).Les Tramways des Alpes-MaritimesLe
21 août 1909, la première ligne de tramways départementaux TAM fut
ouverte provisoirement en traction vapeur (33.8 km). Elle sera
électrifiée le 31 Octobre 1910.La ligne de
tramway Cagnes-Grasse (25 km) fut ouverte à l’exploitation en trois
sections : De Pré-du-Lac à Grasse-Ville (2 Avril 1910), de
Grasse-Ville à Grasse-PLM (1er Mars 1911) et de Cagnes à Pré-du-Lac (30
Décembre 1911). Le 30 Décembre, La ligne (Cagnes) de
Villeneuve-jonction à Vence (10.7 km) fut également ouverte. La ligne
de la Tinée, entre la Mescla et saint-Sauveur sur Tinée, fut la
dernière à être ouverte avant la première guerre mondiale (15 avril
1912). Les deux dernières lignes, bien que préparées, ne furent
ouvertes qu’entre les deux guerres (29 juillet 1923 pour la ligne de
Pont-de-Gueydan à Guillaumes ; 1er octobre 1924 pour la ligne de
Pont-Charles-Albert à Roquesteron), à contre-cœur par la Compagnie du
Sud-France, dans une périodes où les premiers autocars faisaient une
rude concurrence aux tramways.
aux wagons du Sud France de rejoindre le port de Nice, et favoriser
ainsi les échanges commerciaux entre l’international (via le port) et
le haut pays sans transbordement (les tramways de Nice sont alors en
écartement métrique).Les Tramways des Alpes-MaritimesLe
21 août 1909, la première ligne de tramways départementaux TAM fut
ouverte provisoirement en traction vapeur (33.8 km). Elle sera
électrifiée le 31 Octobre 1910.La ligne de
tramway Cagnes-Grasse (25 km) fut ouverte à l’exploitation en trois
sections : De Pré-du-Lac à Grasse-Ville (2 Avril 1910), de
Grasse-Ville à Grasse-PLM (1er Mars 1911) et de Cagnes à Pré-du-Lac (30
Décembre 1911). Le 30 Décembre, La ligne (Cagnes) de
Villeneuve-jonction à Vence (10.7 km) fut également ouverte. La ligne
de la Tinée, entre la Mescla et saint-Sauveur sur Tinée, fut la
dernière à être ouverte avant la première guerre mondiale (15 avril
1912). Les deux dernières lignes, bien que préparées, ne furent
ouvertes qu’entre les deux guerres (29 juillet 1923 pour la ligne de
Pont-de-Gueydan à Guillaumes ; 1er octobre 1924 pour la ligne de
Pont-Charles-Albert à Roquesteron), à contre-cœur par la Compagnie du
Sud-France, dans une périodes où les premiers autocars faisaient une
rude concurrence aux tramways. Toutes les lignes TAM ont été fermées entre 1929 et 1933.
Ces
différentes ouvertures et raccordements de lignes permettaient une
exploitation de marchandises importante et un véritable service de
« porte à porte » pour les passagers comme pour le fret.
- Transport du charbon du port de Nice vers les cimenteries de St Martin du Var, La Lauzière, Baus-Roux.
- Transport de charbon vers les usines à gaz de Grasse et Draguignan, et la grande centrale thermique de Lingostière
- Transports de produits chimiques de Plan du Var à Nice.
- Transport de bétail, bois, produits agricoles, du haut pays vers Nice.
De nombreuses industries se sont implantées autour de la gare du Sud, pour bénéficier des embranchements ferroviaires.
EXTENSIONS ET AJOUTS AUTOUR DU BATIMENT PRINCIPAL
Dans
les années 1910, avec l’augmentation du trafic, la remise à locomotives
a été agrandie. Les deux réservoirs à eau furent montés sur des socles
en maçonnerie.
Plusieurs locaux annexes ont
été créés (la plupart accolés à la remise): Bureau du chef de
réserve, poste des agents roulants, magasin de traction…
Un
bureau central a été édifié à l’ouest de la gare en bordure de la rue
Dabray pour regrouper la Direction locale de l’exploitation.
En 1936, un nouvel atelier pour les autorails diesels a été construit à l’extrémité ouest du hall des voyageurs.
A la veille de la seconde guerre mondiale, la gare était à son extension maximale.
Hors
bâtiments, il y a plusieurs kilomètres de voies dans l’emprise de la
gare de Nice, dont une partie électrifiée, mais aussi :
- quarante quatre aiguilles simples
- quatre aiguilles triples
- 17 plaques tournantes simples (croix)
- 7 plaques tournantes à voies en étoile
- un pont tournant à locomotives
Après
la seconde guerre mondiale, un bâtiment, servant d’atelier de
réparations simples, sera la dernière construction de cette gare.
LE DECLIN DES LIGNES
FIN DE TRAMWAYS DES ALPES-MARITIMES
Au
début des années 30, les fermetures successives des tramways TAM,
concurrencés par les autocars, suppriment quelques débouchés.
DESTRUCTION DE TROIS VIADUCS
Le
24 Août 1944 à 5h00 du matin, un commando allemand détruit à l’explosif
trois des principaux ouvrages de la ligne du Central-Var : Le
viaduc de la Siagne, le viaduc du Loup et le viaduc de la Pascaressa
(près de Tourettes-sur-Loup). Ces destructions, ainsi que celle du pont
de la Manda par un bombardement américain, précipiteront la fin,
quelques années plus tard, de cette ligne.
DERNIERE CIRCULATION OFFICIELLE DES TRAINS SUR
LA LIGNE DU LITTORAL
Officiellement,
le 2 juin 1948, les trains s’arrêtent de circuler. Mais, fait original
prouvant l’intérêt de cette ligne qui a connu un immense succès
populaire jusqu’à son dernier jour, des autorails continueront pourtant
de circuler jusqu’au 4 juin 1949, les « rames » d’autocars
étant incapables de répondre à l’intensité du trafic que générait la
ligne du Littoral.
FERMETURE DE LA LIGNE DU CENTRAL-VAR
La
ligne du Central-Var, amputée de son tronçon Tanneron-Colomars depuis
1944, voit son sort scellé par par décision ministérielle le 4 novembre
1949. La dernière circulation des trains aura lieu le 2 janvier 1950.
La voie sera ensuite intégralement démontée malgré l’opposition de
nombreux élus locaux. Plus une seule ligne des Chemins de fer de
Provence (changement de nom en 1933) n’existe désormais dans le Var et
dans les Bouches-du-Rhône. 132 agents seront licenciés.
FERMETURE DES TRAMWAYS DE NICE
Les dernières lignes de tramways de Nice, permettant un débouché sur le port, sont fermées en 1953.
SUPPRESSION DE LA VOIE DE RACCORDEMENT SNCF-CP A NICE
Le
dernier train circule Rue des Anciens Combattants AFN, sur la voie
ferrée reliant la Gare Thiers (SNCF) à la Gare du Sud (CP) le 25 mai
1967. Cette voie sera démontée peu de temps après.
LES MENACES ET L'INCERTITUDE
A
partir de 1958 et la première menace de fermeture de la ligne
Nice-Digne, les Chemins de fer de Provence entrent dans une période
d’incertitudes et de sous-financements qui contribuent au délabrement
de ses installations.
PREMIERE MENACE DE FERMETURE PAR L’ETAT
A
l’automne 1958, l’état établit une étude pour la fermeture de la ligne
Nice-Digne au 31 Mars 1959, ou un sursis de cinq ans assorti de mesures
d’économies draconiennes : fermeture de gares, des ateliers,
réduction de personnel, suppression de trains. Les élus se mobilisent
(dont Jean Médecin, maire de Nice) et proposent une participation de la
ville de Nice et des deux départements aux dépenses liées au train.
NOUVELLE MENACE DE FERMETURE DE LA LIGNE PAR L’ETAT
A
l’automne 1966, les ministères concernés annoncent leur intention de
fermer la ligne au 1er Juillet 1967. Devant les nombreuses pétitions et
interventions publiques, l’état annonce le 28 Octobre 1966 un sursis à
l’exploitation. Diverses propositions d’exploitation allégée sont
envisagées.
ENCORE UNE MENACE DE FERMETURE DE LA LIGNE PAR L’ETAT
Après
étude de la ligne et contacts pris avec les représentants des
collectivités locales, l’Etat envisage à nouveau, en Octobre 1967, de
fermer la ligne en avril 1968. La décision de créer un Syndicat Mixte
(futur SYMA) est prise par les collectivités locales le 5 Janvier 1968
pour reprendre progressivement la charge financière de l’exploitation.
PREMIERES MENACES DE SUPPRESSION DE LA GARE DU SUD
En
1970 le terminus de Nice est menacé d’un recul à la rue Cros de Capéu
(recul de 700 mètres), supprimant du même coup 4 passages à niveau,
mais excentrant la gare terminus des CP loin du centre attractif de
Nice. Les terrains pour la construction de la nouvelle gare sont
achetés en 1972, l’architecte choisi. Ce projet en restera
(heureusement) à ce stade.
Envahis par la végétation, une partie des rails inutilisés de la gare sont démontés et ferraillés en 1973.
MENACE DE FERMETURE DE LA LIGNE ET
NOUVELLE DEMANDE DE CESSION DE LA GARE DU SUD
Le
Président du SYMA, Jacques Médecin, Maire de Nice, déclare avoir
l’intention de cesser la participation financière de l’organisme en
1975, et demande la cession des terrains de la gare de Nice. Une
entente sera trouvé le 23 Mai, les CP cédant à la mairie de Nice tous
ses terrains au sud de la Gare de Nice.La même année, 150 wagons, réformés en 1962, sont démolis sur place et ferraillés. Les locaux au sud de la gare sont démolis.En, 1976 , les emprises de la gare sont coupées en deux par le raccordement de la rue Alfred Binet et de la rue de Falicon.L’accès à la halle marchandises et les manœuvres des trains deviennent presque impossibles. Le
22 mars 1977, les barrières automatiques des rues Gambetta, Cros de
Capeu, Gutemberg sont supprimées et remplacées par des feux
tricolores !On impose alors aux trains de passer les carrefours à 4 km/h. Le
22 mars 1977, les barrières automatiques des rues Gambetta, Cros de
Capeu, Gutemberg sont supprimées et remplacées par des feux
tricolores !On impose alors aux trains de passer les carrefours à 4 km/h.
CIRCULATION DU TERNIER TRAIN MARCHANDISES
Un
plan de redressement est mis en place, l’une des mesures étant la
suppression des trains entiers de marchandises, activité déficitaire
due à un matériel vétuste. Cette mesure sera effective le 24 septembre
1977. A partir de cette date plus aucun train de marchandise n’entrera
dans le centre de Nice.
En 1978, la partie sud de la gare est transformée en parking, la halle « petite vitesse » est démolie.
NOUVELLES MENACES SUR LA LIGNE
Une
période de dix ans de calme relatif s’ensuit. Mais l’objectif avoué de
la Mairie de Nice est de récupérer tous les terrains de la Gare du Sud.
Le
Conseil Municipal de Nice demande le 17 avril 1989 la fermeture de la
ligne au-delà de Colomars (raccourcissant la ligne de 150 à… 14 km). La
Mairie de Nice exerce ainsi une forte pression pour la cession de la
gare historique de Nice.
FIN DU TRONCON SNCF DIGNE – ST-AUBAN La SNCF interrompt toute circulation ferroviaire sur l’antenne de Digne à Saint-Auban
le 23 septembre 1989, mettant fin par la même occasion à l’Alpazur
(liaison Nice-Grenoble-Genève) et isolant les Chemins de fer de
Provence à leur terminus de Digne.
PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA CESSION DE LA GARE DU SUD
Un
protocole d’accord est finalement signé le 18 janvier 1991 pour la
cession des terrains de la Gare du Sud à Nice, bâtiment et terrains, et
le report de la gare rue Alfred Binet, pour un montant de 151 millions
de francs.
FIN DE L’ACTIVITE DE LA GARE DU SUD
La
mise en service de la nouvelle gare de la rue Alfred Binet était
initialement prévue pour le mois de novembre 1991, puis repoussée au 10
décembre en raison du retard pris par les travaux de la nouvelle gare
minimaliste. Dans la précipitation, à moins de six mois d’un centenaire
qui aurait pu être fêté dans la dignité, la Gare du Sud cesse toute
activité le 9 décembre 1991. Depuis, elle pourrit…
|
LA GARE DU SUD EN DETAILS
Le
corps central du bâtiment, de belles proportions, correspond à la salle
des pas-perdus. Les trois portes d'accès sont encadrées de colonnes et
surmontées d'un étagement d'éléments décoratifs d'inspiration
néoclassique: de bas en haut, le cartouche frappé du millésime de la
construction, 1892; l'horloge; la verrière semi-circulaire qui éclaire
les locaux du premier étage; le macaron gravé au sigle S.F, encadré de
feuilles d'acanthe et supporté par une tête de lion; enfin, le fronton
à la grecque. Lui-même encadré de deux globes de pierre et orné d'un
buste de femme (peut-être Minerve ou Athéna, déesse des Arts, de la
Science et de l'Industrie), ce fronton arbore un cartouche de grandes
dimensions ou s'étale en toutes lettres la raison sociale de la
compagnie.
De part et d'autre de cette pièce centrale, deux ailes
correspondant à la largeur des quais abritent d'une part les bureaux
des recettes, de l'autre le buffet-buvette. A chaque extrémité, elles
se terminent par un pavillon à deux étages présentant une façade à
fronton côté cour et une tourelle à toiture conique côté voie. Ces
pavillons, de même que les locaux au premier étage des ailes et du
bâtiment, abritent des logements destinés aux agents de la gare.
Le
parement de la façade, harmonieusement encadré de chaînons de pierres
de taille, se compose de briques teintées de différentes couleurs, en
jaune, rose et rouge, dessinant des motifs à croisettes et des frises
géométriques à la grecque. De petits carreaux de faïence émaillée à
rosace complètent la décoration de l'ensemble, qui même de nos jours,
après avoir subi les outrages du temps et du manque d'entretien,
conserve un aspect coloré et plaisant.
Côté voies, la
« marquise » métallique monumentale conditionne par ses
dimensions celles de l'ensemble du bâtiment: sa charpente provient en
effet de la récupération de la nef d'un pavillon de l'Exposition
Universelle de 1889 qui s'est tenue quelques mois auparavant au Quai
d'Orsay à Paris. Cette halle est supportée par vingt-deux piliers de
fer qui soutiennent également deux galeries basses latérales abritant
les quais proprement dit.
Le long du quai sud, affecté aux départs
aucun local annexe n'est accolé mais une porte latérale donne accès à
un petit bâtiment de briques au style assez soigné qui rassemble les
cabinets de toilette, l'atelier d'héliogravure où sont imprimés les
circulaires et les notes de service de la compagnie, ainsi que le
bureau de l'Octroi municipal, qui contrôle l'accès à la cour de la
«petite vitesse». Le long du quai nord, affecté aux arrivées, une série
de locaux annexes abritent une lampisterie une salle à bagages, la
consigne, le commissariat spécial de la gare et un autre bureau
d'Octroi. La sortie s'effectue sui la Place de la Gare du Sud, alors
lieu de rassemblement des calèches et des taxis. En tête de quais,
enfin, se trouvent le bureau du chef de gare, une bascule à bagages de
500 kg, le poste et le vestiaire des chefs de trains (alors dénommés
«conducteurs»).
Les dimensions principales du bâtiment des
voyageurs sont de 42,50m de large sur 12,50m de profondeur. L'ensemble
de la verrière couvre une surface de 87,50 par 22,50m.
Extrait de "Le Train du Sud" N°13, GECP
LA GARE D'HIER
A AUJOURD'HUI...

La
façade de la gare, à son époque de gloire! Les palmiers ont grandi et
l'électricité a remplacé le gaz dans les beaux réverbères de fonte...
(Document G. de Santos, Train du Sud N°13, Coll. GECP)

Fronton de la Gare du Sud
(Train du Sud N°13, Coll. GECP)

Nettoyage de l'horloge
(Train du Sud N°13, Coll. GECP)

Une situation exceptionnelle au coeur de la ville qui ne manque pas d'attirer les convoitises
(photo Pascal Bejui, 1980, Train du SUd N°13, Coll. GECP)

Vue très rare du dépôt et des faisceaux marchandises, prise de la marquise en 1937 (Photo Gramin Bernardin, Train du Sud N°13, coll. GECP)

L'arrivée des voyageurs d'une navette de banlieue, le 9 décembre 1991
(Photo José Banaudo,Train du Sud N°43, Coll. GECP)

La Navette 208A en provenance de Colomars (X-326) entre sous la verrière alors que le train 5A va démarrer vers Digne.
(Photo José Banaudo,Train du Sud N°43, Coll. GECP)

Dans l'après-midi du 9 décembre, la voiture du train 4A rentre au dépôt (X-304)
(Photo José Banaudo,Train du Sud N°43, Coll. GECP)

La façade de la gare, en février 2006
(Photo Adrien Mortini, site Structurae)

Vue générale de la gare pendant les travaux du tramway en 2006
(Photo Adrien Mortini, site Structurae)

L'entrée de la gare en 2005
(Photo W. Waechter, Coll. CCCP)

Côté sud en 2005, vue arrière de la façade
(Photo W. Waechter, Coll. CCCP)

Côté nord en 2007, vue arrière de la façade
(Photo Cendra, coll. CCCP)

La verrière en décembre 2007
(Photo Cendra, coll. CCCP)

A l'intérieur de la verrière, décembre 2007
(Photo W. Waechter, Coll. CCCP)

Face sud
(Photo W. Waechter, Coll. CCCP)

La verrière
(Photo W. Waechter, Coll. CCCP)

Le fronton, la raison sociale
(Photo Adrien Mortini, site Structurae)

Détails du fronton en 2006
(Photo Adrien Mortini, site Structurae)
|